Le temps de l’engagement
Partagez maintenant sur :
Les drames que le Congo a connus récemment ont provoqué, comme ceux qui les ont précédés, une vive émotion. A juste titre. Le 1er février, une cinquantaine de Congolais ont été massacrés par un groupe rebelle dans la province de l’Ituri. Le lendemain, c’est vingt-six personnes qui ont été tuées dans la chute d’un câble électrique de haute tension sur un marché de la ville de Kinshasa. Le même jour, un accident de circulation a fait quatre morts dans la même ville. Un peu plus tard dans la soirée, à l’autre bout du pays, cinq autres personnes ont été tuées par des rebelles ADF à Nobili, localité congolaise du territoire de Beni au Nord-Kivu.
Sur les réseaux sociaux ont émergé des messages de compassion, d’indignation et de colère à la suite de tant de drames qui ont endeuillé le pays en si peu de temps, privant de tant de personnes des êtres chers : un enfant chéri, un père adorable, une mère aimante, un époux attentionné, une compagne dévouée.
De nombreux compatriotes vont être marqués à jamais par la disparition d’un proche avec qui ils avaient confectionné des projets. Avec qui ils partageaient un rêve, une ambition.
Normal donc que l’indignation s’empare de nous face à autant de douleur.
Mais comme l’ont fait remarquer aussitôt d’autre internautes, ces drames sont malheureusement devenus trop courants au pays. Et ces indignations comme un rituel. Créer un hashtag ou un visuel après un drame dans lequel de nombreux compatriotes ont péri est presque devenu une habitude, le temps du deuil. Un temps de plus en plus court. Le temps qu’un autre sujet de l’actualité vienne chasser ce drame de nos journaux, de nos alertes AFP, de nos timeline. Nous faisant oublier le sens profond de notre indignation : les drames évitables doivent donner lieu à des réflexions et à des décisions qui doivent aboutir à l’action. Car si l’indignation ne conduit pas à l’action, elle est inutile.
Tristesse civique
Dans un discours prononcé en 1957, Albert Camus parle de ce type d’indignation qu’il qualifie de «tristesse civique» qui «ne change rien à la réalité».
Car comme le fait savoir le père Alain Joseph Lomandja sur son compte Twitter, «transformer l’indignation en force d’engagement citoyen, tel est le défi».
L’ecclésiastique ajoute : «Sans un engagement en politique ou, alors, la création des groupes de pression, rien de durable n’émergera de ces indignations saisonnières. Il est plus que temps d’envahir la rue et l’arène politique».
Les réseaux sociaux ont acquis ces dernières années une telle puissance qu’il ne viendrait à l’idée de personne de douter de leur force de mobilisation.
Des mobilisations sur les réseaux sociaux ont conduit à la révocation des membres du gouvernement, à des interpellations d’agents de l’ordre qui ont fait de la brutalité une expression de leur autorité, à faire annuler des évènements publics organisés par des personnes en délicatesse avec la loi, etc. Des photos, des vidéos ont obligé les pouvoirs publics à sortir de leur torpeur pour agir. Sans les réseaux sociaux, beaucoup de scandales financiers n’auraient peut-être pas été portés sur la place publique.
Mais comme toutes les inventions humaines, les réseaux sociaux portent en eux leurs propres limites. A force de déverser sur ces outils nos peines, douleurs, indignations, colères et récriminations- quelque fois légitimes- nous en avons également fait des lieux de spectacle où on ne distingue plus le vrai du vraisemblable. L’essentiel de l’accessoire. Nous en avons fait des tribunaux où des milliers de procureurs prononcent des réquisitoires sans jamais avoir lu le dossier ni enquêté. Nous en avons fait des déversoirs de nos passions et de nos frustrations. Bref des lieux où l’argument lucide, réfléchi et porté avec modération est inaudible. Où l’invective est la norme. L’injure, un moyen d’expression. Et où l’hystérie et la précipitation font passer l’action pensée et réfléchie pour de la mollesse.
Dans cet environnement, difficile donc de construire à partir des indignations pourtant légitimes.
Engagement citoyen
Car si on peut parfaitement exprimer son engagement citoyen sur les réseaux sociaux, on ne saurait s’y cantonner.
Comme le note très justement le père Alain Joseph Lomandja, «les réseaux sociaux offrent aux citoyens d’énormes opportunités d’interactions avec les dirigeants et d’une gouvernance plus participative. Mais une de leurs limites reste ces élans d’indignation sans lendemain».
Car seul l’engagement citoyen peut permettre à un groupe d’individus de faire bouger la communauté dans le sens qu’il juge opportun. Puisqu’après les indignations, les dénonciations et les colères, vient le temps du «On fait quoi maintenant ?».
Puisque l’indignation ne fait pas office de politique, il vaut mieux que chacun «fasse sa part». Faire sa part, c’est donner un peu de soi pour faire aboutir une revendication en politique publique. Et pour cela, il faut agir.
«Il ne va plus suffire de tweeter, de lever les yeux au ciel ou d’espérer silencieusement au milieu du fracas d’un monde qui s’écroule autour de nous, que le salut vienne d’ailleurs, d’en haut ou d’en bas, de gauche ou de droite, du Nord ou du Sud. Le salut ne peut venir que de l’intérieur, que de la force et de la décision d’agir», prescrit Xavier Alberti sur son blog.
Membre d’une communauté, nous avons tous une partition à jouer. Individuellement, d’abord. Ensuite, collectivement, pour faire entendre au plus grand nombre la belle mélodie conçue dans le silence et le secret de la création.
Citons encore Albert Camus : «Nous avons tous quelque chose à faire, n’en doutons pas. Chaque Homme dispose d’une zone plus ou moins grande d’influence. Il la doit à ses défauts autant qu’à ses qualités».
Sortir de nos incohérences
L’engagement citoyen peut revêtir de nombreuses formes. La plus élémentaire- et aussi la plus coûteuse- est de faire ce que l’on fait le mieux qui soit.
La majorité des maux qui rongent notre pays sont en fait le résultat de nos propres incohérences.
Un enseignant qui demande à son collègue de donner une bonne note à l’une de ses élèves qui a échoué, lui expliquant qu’elle est la fille de sa sœur a failli à sa mission d’éducateur.
Un juge qui refuse de rendre un verdict qu’il sait en défaveur d’un proche dont il a refusé de signaler la relation à ses supérieurs au début de l’instruction a trahi son serment.
Un journaliste qui refuse de publier une information vérifiée d’intérêt général pour ne pas enfoncer un proche en difficulté a commis une faute déontologique.
Un responsable de l’administration qui fait entrer dans la fonction publique femme, enfants et neveux sans aucun respect des procédures d’admission sous statut trahit le pays.
Chaque adulte congolais connaît au moins une situation où il a été amené à faire un choix entre ses intérêts personnels et le bien de la communauté. A chaque fois que nous avons privilégié l’intérêt personnel au détriment du bien collectif, nous avons manqué à notre engagement citoyen. C’est de cela d’abord que le pays souffre. Les hashtags et les campagnes sur les réseaux sociaux n’y changeront rien.
Réclamer un changement de mentalités sur les réseaux sociaux et arriver tous les jours au travail en retard est une incohérence.
Action politique
Mais l’engagement citoyen ne saurait se limiter à cela.
Comme beaucoup de personnes de ma génération, j’ai été élevé dans une relative détestation de la classe politique. Je n’ai pas connu l’enseignement public gratuit. J’ai vu mes parents – et pas seulement – se saigner de toutes les veines pour m’envoyer à l’école. J’ai fait le «rail» dans le taxi-bus pour arriver à temps aux cours, faute de moyens de transport public de qualité. J’ai étudié avec un millier de personnes dans un auditoire qui ne devait en compter que deux cents.
Journaliste, j’ai visité des prisons de plus de huit cents détenus – dont plusieurs mal nourris – dans des installations qui ne devaient en compter que trois cents. J’ai vu des détenus accusés de graves crimes marcher à pied pendant plus d’une demi-heure, escortés par quelques policiers, de la prison au tribunal. Faute de moyens de transport. Des exemples similaires, j’en remplirais des pages.
Comment, après tout ça, ne pas développer une certaine aversion envers la classe dirigeante. Mais l’aversion comme la haine ou la colère ne sont pas des projets politiques. Une colère n’a jamais rien changé.
Le monde politique est pourri, j’entends souvent dire autour de moi. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas s’y intéresser ou pour ne pas militer. D’ailleurs s’il est dans cet état, c’est à cause du renoncement de bonnes gens. Font la politique, ceux qui s’y risquent. Les commentateurs-spectateurs, du haut de leur supposée pureté, n’y changent jamais rien. Et ils en subissent les décisions. Car, l’exercice dévoué, sérieux et désintéressé d’un mandat ou d’une fonction publique peut influencer l’organisation et le fonctionnement d’une communauté.
Comme l’écrit très justement Xavier Alberti, «la politique n’est pas morte et les engagements qu’elle implique ne méritent pas l’ironie qu’ils suscitent».
L’entrepreneur ajoute :
«L’engagement politique reste une des formes les plus nobles d’action quand il est dicté par l’intérêt général. Il représente même une forme de sacrifice pour celles et ceux qui s’engagent dans cette voie bordée d’ingratitude et de violences».
L’ancien président français Nicolas Sarkozy aime à dire que la politique est le dernier terrain des aventures humaines collectives.
Que l’on fasse partie d’un groupe de pression, d’un parti politique ou que l’on choisisse d’utiliser son travail pour vivre le changement que l’on souhaite, l’important est d’agir pour le bien de tous.
Et ces mots de M. Alberti pour conclure ce billet : «Quand l’histoire prend sa forme la plus tragique, seule la force de la création et de l’engagement peut répondre aux défis qui se dressent au cœur de nos sociétés, qu’il s’agisse de la fragmentation sociale, de la catastrophe climatique ou de l’hypertrophie technologique».

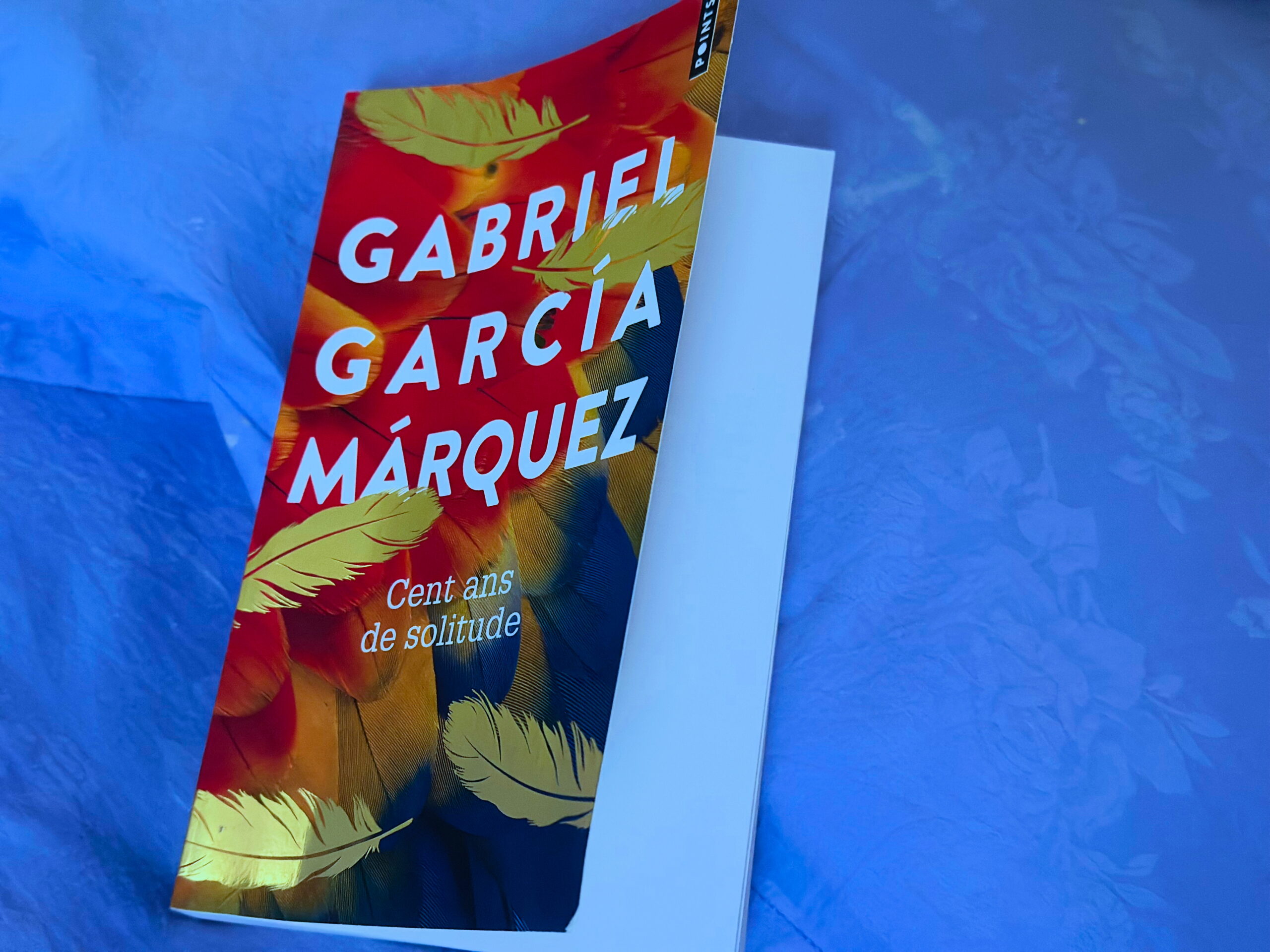
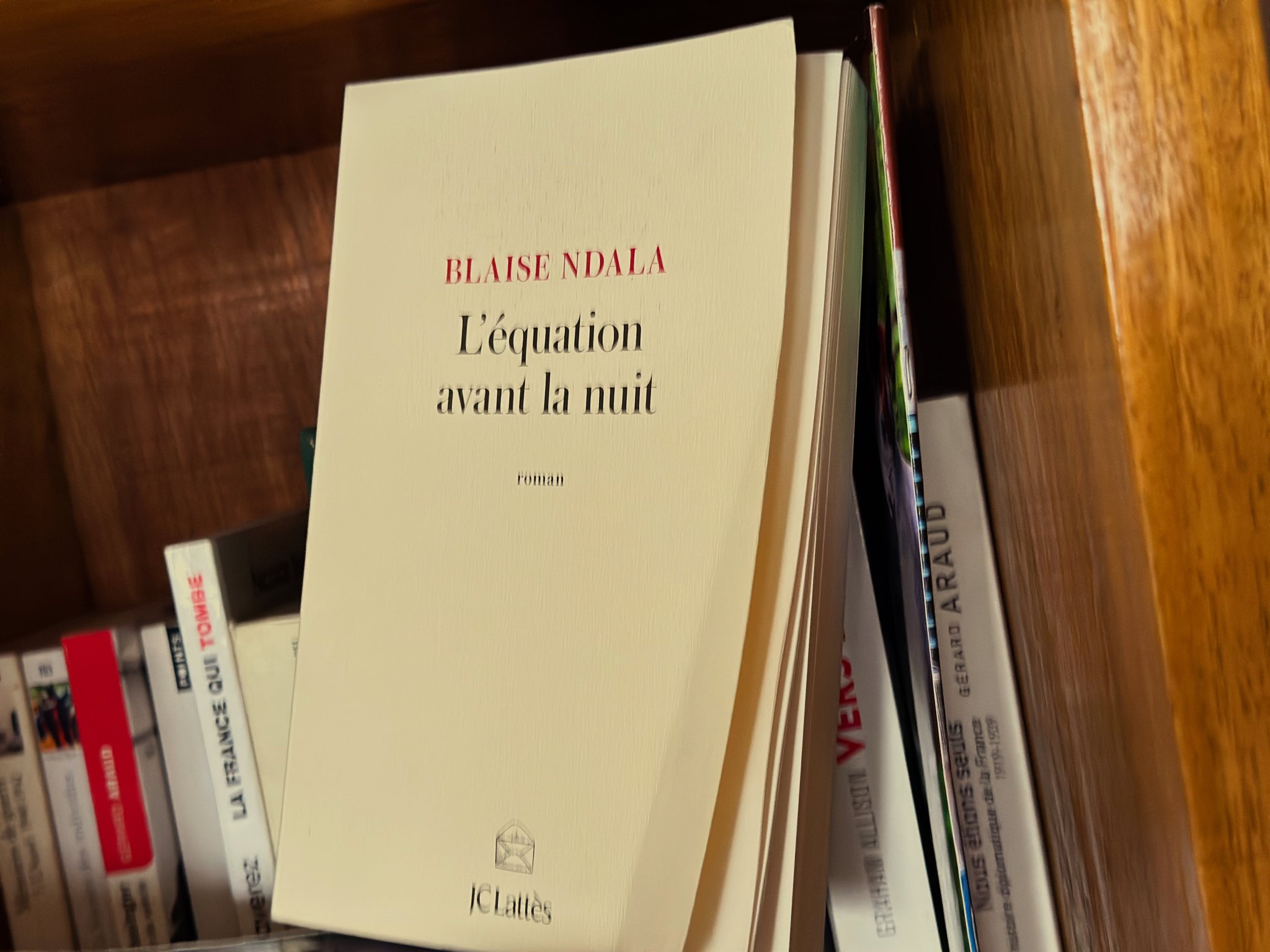











6 comments