«Si c’est un homme»
Partagez maintenant sur :
Je ne sais plus quand est-ce que j’ai entendu parler de Primo Levi pour la première fois. Mais je me souviens parfaitement de ce qui m’a décidé à le lire.
C’était il y a trois ans. Je lisais le blog de Xavier Alberti et je suis tombé sur cette phrase :
«Tous les jours, pendant six mois, un ouvrier civil m’apporta un morceau de pain et le fond de sa gamelle de soupe».
Capable du pire…
L’extrait est tiré de «Si c’est un homme», le premier livre écrit par Primo Levi à sa sortie du camp de concentration.
Primo Levi est un ancien déporté. En février 1944, il est arrêté comme résistant en Italie et envoyé dans un camp. Déporté à Auschwitz, il n’en sort qu’en janvier 1945 quand le camp est libéré par l’armée soviétique.
«Si c’est un homme» est le journal de sa déportation. Hier, en refermant la dernière page du livre, je ne me suis pas empêché de penser que si l’être humain est capable du meilleur, il est également capable du pire.
«Au bout de quinze jours au Lager, je connais déjà la faim règlementaire, cette faim chronique que les hommes libres ne connaissent pas, qui fait rêver la nuit et s’installe dans toutes les parties de notre corps ; j’ai déjà appris à me prémunir contre le vol, et si je tombe sur une cuillère, une ficelle, un bouton que je puisse m’approprier sans être puni, je l’empoche et le considère à moi de plein droit. Déjà sont apparues sur mes pieds les plaies infectieuses qui ne guériront pas. Je pousse des wagons, je manie la pelle, je fonds sous la pluie et je tremble dans le vent. Déjà mon corps n’est plus mon corps. J’ai le ventre enflé, les membres desséchés, le visage bouffi le matin et creusé le soir ; chez certains, la peau est devenue jaune, chez d’autres, grise ; quand nous restons trois ou quatre jours sans nous voir, nous avons du mal à nous reconnaître.»
C’était cela la vie dans un camp de concentration.
Un système pensé et mis en place par le régime Nazi au pouvoir en Allemagne pour denier toute humanité à ceux qui y étaient envoyés.
Ce qui fait la force de «Si c’est un homme», ce n’est pas seulement la description des conditions de vie dans un camp de concentration.
Dans ce livre, Primo Levi donne à penser. «Si c’est un homme» est un livre sur l’être humain.
«Si on devait vous tuer demain avec votre enfant, refuseriez-vous de lui donner à manger aujourd’hui ?».
Primo Levi s’adresse à chacun de nous. Il parle du camp de concentration pour nous interroger, nous questionner sur notre humanité :
«Celui qui tue est un homme, celui qui commet ou subit une injustice est un homme. Mais celui qui se laisse aller au point de partager son lit avec un cadavre, celui-là n’est pas un homme. Celui qui a attendu que son voisin finisse de mourir pour lui prendre un quart de pain est, même s’il n’est pas fautif, plus éloigné du modèle de l’homme pensant que […] le plus abominable des sadiques.»
C’est pourtant à cela que sont réduites les personnes forcées à l’esclavage dans les camps de concentration.
…comme du meilleur
Ce qui fait la force de ce livre, c’est aussi, et surtout, l’absence de haine dans ces pages si douloureuses. Primo Levi a connu le pire. Mais son récit est dénué de toute rancœur.
L’édition de «Si c’est un homme» que Pascale a eu la gentillesse de m’offrir comporte un appendice qui reprend des réponses aux questions qui ont souvent été posées à l’auteur par les personnes qui ont lu son ouvrage. Primo Levi répond notamment à la question du désir de vengeance.
«La haine est assez étrangère à mon tempérament, fait-il savoir. Elle me paraît un sentiment bestial et grossier, et, dans la mesure du possible, je préfère que mes pensées et mes actes soient inspirés par la raison ; c’est pourquoi je n’ai jamais, pour ma part, cultivé la haine comme désir primaire de revanche, de souffrance infligée à un ennemi véritable ou supposée, de vengeance particulière.»
Primo Levi est de ces hommes qui sont étrangers à la haine. L’être humain est donc aussi capable du meilleur.
C’est le sens de l’extrait que Xavier Alberti citait sur son blog. En version plus longue, il donne ceci :
«L’histoire de mes rapports avec Lorenzo est à la fois longue et courte, simple et énigmatique. […] En termes concrets, elle se réduit à peu de chose : tous les jours, pendant six mois, un ouvrier civil m’apporta un morceau de pain et le fond de sa gamelle de soupe ; il me donna un de ses chandails rapiécés et écrivit pour moi une carte postale qu’il envoya en Italie et dont il me fit parvenir la réponse. Il ne demanda rien et n’accepta rien en échange, parce qu’il était bon et simple, et ne pensait pas que faire le bien dût rapporter quelque chose.»
C’est joliment dit. Mais plus que cela, c’est l’humanité dans ce qu’elle a de plus de beau et de plus digne qui est exprimée ici.
Dans ce camp de concentration où chacun lutte pour sa survie et où tout est transaction, Lorenzo n’accepte rien en échange de sa générosité.
Son humanité est d’autant plus exceptionnelle que Primo Levi lui-même fait, à la fin de son livre, ce constat sans appel :
«Ils avaient bel et bien fait de nous des bêtes.»
Le système mis en place par le régime Nazi pour exterminer les juifs ne se limitait pas aux chambres à gaz ou aux exécutions sommaires. Il s’agissait bien d’une entreprise de deshumanisation :
«C’est dans la pratique routinière des camps d’extermination que la haine et le mépris instillés par la propagande nazie trouvent leur plein accomplissement. Là en effet, il ne s’agit plus seulement de mort, mais d’une foule de détails maniaques et symboliques, visant tous à prouver que les juifs, les Tziganes et les Slaves ne sont que bétail, boue et ordure. Qu’on pense à l’opération de tatouage d’Auschwitz, par laquelle on marquait les hommes comme des bœufs, au voyage dans des wagons à bestiaux qu’on n’ouvrait jamais afin d’obliger les déportés (hommes, femmes et enfants !) à rester des jours entiers au milieu de leurs propres excréments, au numéro de matricule à la place du nom, au fait qu’on ne distribuait pas de cuillère, les prisonniers étant censés laper leur soupe comme des chiens…».
La raison comme refuge
Quand on achève la lecture de «Si c’est un homme», on ne peut pas ne pas se poser la question ultime : pourquoi ? Pourquoi en est-on arrivé là ?
Dans l’appendice du livre que j’évoquais plus haut, Primo Levi tente d’y répondre.
Mais au-delà de la question du pourquoi, il nous met en garde et nous interpelle.
Primo Levi nous met en garde contre notre propension à désirer des hommes providentiels, des «chefs charismatiques».
«Tous nous devons savoir, ou nous souvenir, que lorsqu’ils parlaient en public, Hitler et Mussolini étaient crus, applaudis, admirés, adorés comme des dieux. C’étaient des ‘’chefs charismatiques’’, ils possédaient un mystérieux pouvoir de séduction qui ne devait rien à la crédibilité ou à la justesse des propos qu’ils tenaient mais qui venait de la façon suggestive dont ils les tenaient, à leur éloquence, à leur faconde d’histrions…», écrit-il.
Primo Levi nous rappelle que ces personnages tenaient des propos cruels et abjects mais ils étaient acclamés et «suivis jusqu’à la mort par des milliers de fidèles».
Comme souvent dans l’histoire, on en vient à se questionner sur le rôle des gens ordinaires :
«Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux ; ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter, comme Eichmann, comme Hoss, le commandant d’Auschwitz, comme Stangl, le commandant de Treblinka, comme, vingt ans après, les militaires français qui tuèrent en Algérie, et comme, trente ans après, les militaires américains qui tuèrent au Viet-nam.»
Hier comme aujourd’hui, ce sont eux les plus dangereux, ces gens qui sont «prêts à croire et à obéir sans discuter».
C’est ce que retient de «Si c’est un homme».
Pendant cette période tragique de l’histoire, la raison a sommeillé. L’humanité a vacillé. Il s’est alors produit ce qui se produit à chaque fois où l’être humain décide de ne pas écouter la raison et d’obéir aveuglement.
Cela se passe encore aujourd’hui dans nos vies personnelle, sociale et professionnelle. Nos familles, nos entreprises et nos Etats en sont des exemples.
C’est pour cette raison que nous devons constamment nous interroger sur les bienfondés de nos décisions et nous assurer que nos actes ne sont pas en contradiction avec les grands principes que nous professons : liberté et fraternité. C’est pour cela que nous ne devons pas cesser de livrer le bon combat :
«À force de sacrifier ce que nous avons en partage au nom de ce qui nous sépare, à force de tourner le dos à l’effort collectif pour préférer le confort individuel, à force de délaisser les communs qui réunissent pour préférer les particularismes qui définissent, peut-être avons-nous perdu de vue le combat qu’il nous faudra toujours livrer, celui contre nous-même, contre nos propres faiblesses, nos propres lâchetés et nos propres tentations.»
Primo Levi est mort en 1987. Son œuvre parle à chacun de nous.
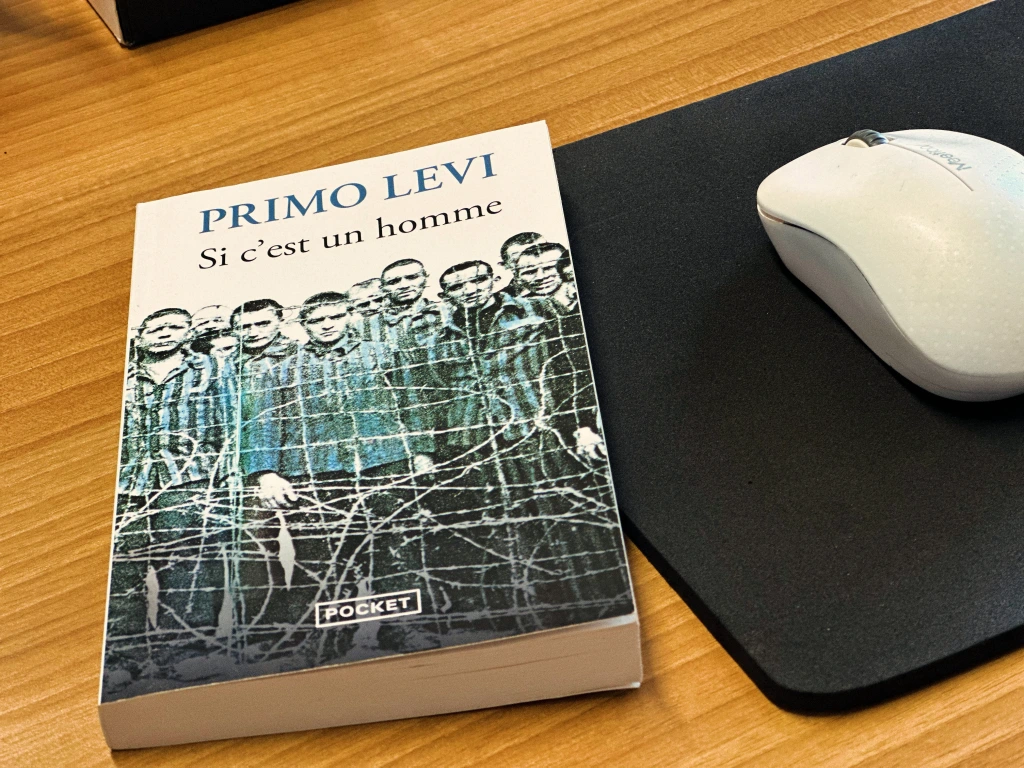













3 comments