La nuance, point d’équilibre d’un monde en déséquilibre
Partagez maintenant sur :
Le drame qui se déroule actuellement au Proche-Orient doit nous inciter à reconsidérer cette façon que nous avons de tout compartimenter, de classer dans des cases et de nous imposer des choix binaires.
On n’a pas besoin d’applaudir aveuglement la politique israélienne pour estimer que l’attaque du 7 octobre dernier est un acte terroriste qui mérite une désapprobation générale.
On n’a pas besoin de minimiser la barbarie du Hamas pour souligner l’effroyable violence dont sont victimes les Palestiniens à cause de la politique menée par des dirigeants israéliens fanatiques et incapables de penser le bien commun dans cette région qui mérite la paix.
Rien ne doit nous obliger de choisir les uns contre les autres. Ce qui est vrai pour le conflit israélo-palestinien l’est également pour bien d’autres questions pour lesquelles nous sommes littéralement contraints de choisir notre camp. Réduisant ainsi la pensée en un choix simpliste entre le bien et le mal.
Non. La réalité n’est pas simple. Et c’est bien ainsi.
On peut parfaitement condamner l’attaque du Hamas et, dans le même temps, rejeter la réponse militaire qu’apporte actuellement Israël.
On peut parfaitement défendre le droit d’Israël de se défendre et faire savoir que le droit humanitaire international ne doit pas être bafoué.
Malheureusement, dans le monde de l’information instantanée qui est le nôtre, difficile de ne pas se voir taxé de mou ou d’inféodé à tel ou tel autre camp quand on refuse de se laisser enfermer dans des schémas binaires.
«La nuance est une lampe»
Sur le plateau de «La Grande Librairie» sur France 5, la romancière française Maria Pourchet a lu en septembre dernier un très beau texte, faisant l’éloge de la nuance, ce trait de l’esprit si moqué aujourd’hui, pourtant si nécessaire pour l’équilibre de toutes les sociétés humaines :
«Depuis l’enfance, depuis la balle au prisonnier, jusque dans mon lit, on m’a demandé de choisir un camp. Les faibles ou les forts. Littéraire ou scientifique. Vierge ou salope. Israël ou Palestine. L’Europe, oui ou non. Homo ou hétéro. De plus en plus vite et de plus en plus souvent. Rejeter l’un pour appartenir à l’autre. Réac ou éveillé. MeToo ou pas MeToo. Auteur ou autrice. Censeurs ou libertaires. Inscrivez-vous quelque part, on en parle après. Alors, moi qui n’ai jamais été pressée d’appartenir, qui n’aime rien tant qu’écouter les autres raconter le flou intérieur, regarder la pensée en train de se faire comme on regarde couler du café-filtre, j’ai un peu peur. Et si tout ce qu’on avait bossé pour le bac philo – le doute raisonnable et la suspension du jugement – était démonétisé au profit d’un monde simpliste, radical, tailladé des frontières à l’arrache entre les genres, les gens, entre les idées. Un monde inhabitable de positions et d’antagonismes, où «je ne sais pas» ne serait plus une réponse mais une infamie. Simplifier, c’est tentant. Le réel est d’une complexité déroutante. Nous sommes déroutants, troublés, facettés comme du quartz, éperdus, blessés, changeants, amoureux. Nous sommes impensables. Mais simplifier, c’est réduire. Trancher dans le réel, c’est mutiler. Et nous, avec. Et cette part que dans l’impatience d’arbitrer nous pourrions abandonner, c’est la plus riche. Et sûrement, la plus libre. C’est la nuance. Faite d’hypothèses, de temps et de questions, la nuance est une lampe. Elle laisse apparaître le tracé singulier de nos routes, nos raisons profondes, des cohérences soudaines entre des camps, des chatoyants revers de médailles, des rires et d’infinis dégradés dans les vérités, des couleurs inouïes auxquelles il faut encore chercher des noms. La pensée, en somme. Et la littérature.»
Pourquoi alors cette fascination pour les avis tranchés, crûs et sans appel ?
Est-ce parce que «les gens qui parlent sans nuances donnent l’impression d’avoir raison», comme l’explique Étienne Klein ?
Ou est-ce parce que «dans le vacarme permanent de l’hyper-communication, il n’existe plus de place pour ceux qui se taisent, pour ceux qui écoutent, pour ceux qui questionnent et qui doutent», comme le soutient Xavier Alberti ?
Pourtant, c’est grâce au doute que nous pouvons conquérir de nouveaux savoirs. C’est parce qu’on reconnaît qu’on ne sait pas qu’on va chercher à apprendre.
«Je ne sais pas». Une phrase comme l’écrit M. Alberti, «qui semble désormais si peu utilisée, si peu audible, si peu possible même».
Pourtant, nous ne savons pas tout. Et nous ne pouvons pas tout savoir. Et c’est précisément parce que nous ne savons pas tout que nous devons introduire de la nuance sans nos jugements.
De moins en moins patients
Mais la nuance exige de la patience pour écouter, pour comprendre, pour réfléchir.
Savons-nous encore écouter ?
Manifestement, non. En témoigne la qualité de nos débats publics. L’école, la politique, la religion, le climat. Quel que soit le sujet du débat, la discussion laisse rapidement la place à l’hystérie, ennemie de la nuance.
On ne cherche plus à argumenter pour déconstruire l’argumentaire de l’autre. On cherche plutôt à vaincre l’autre au lieu de le convaincre. Le parler cash est ainsi devenu une fin en soi.
A cause de l’hystérie que nos propres comportements ont généré, «le seul moyen de se faire entendre, c’est de parler fort, de parler gras, de parler cash, de parler vite, d’asséner, de transgresser, de choquer».
Abreuvés quotidiennement à la parole instantanée que proposent réseaux sociaux et chaines d’info en continu, nous avons perdu le goût de la parole raisonnée. Du calme qu’elle suppose. Et de la nuance qu’elle impose.
Des citoyens impatients produisent des politiques encore plus impatients. Jamais à court d’idées pour rester au-devant de la scène, les hommes et les femmes politiques ont perdu, eux aussi, le sens de la nuance. Quitte à dire aujourd’hui l’exact contraire de ce qu’on a dit hier. Peu importe, personne ne s’en souviendra.
Nous avons tort de ne pas voir les conséquences de ce comportement sur notre vivre-ensemble.
La démocratie perd de sa substance quand les dirigeants politiques sont capables de dire tout et son contraire. Les citoyens ne leur font plus confiance.
L’école perd de son sens quand les enfants n’y viennent plus pour apprendre ce qui va faire d’eux des hommes, c’est-à-dire des êtres dotés d’un esprit critique.
L’église perd de sa raison d’être dans une société où tout se vaut, où l’autorité est moquée et le sacré dénigré.
C’est malheureusement dans ce monde en déséquilibre que nous sommes. Un monde où la crise devenue permanente «est un formidable révélateur de notre incapacité à avouer nos lacunes, à affronter nos insuffisances».
Comment en sortir ?
En acceptant nos limites, nos insuffisances et nos lacunes. En se donnant le temps d’écouter et de comprendre plutôt que de juger. En argumentant plutôt que d’asséner. En nous souvenant de cette vieille formule : « Que le cordonnier ne juge pas au-delà de la sandale ».
Comme l’écrit Xavier Alberti, cette sentence d’Apelle de Cos est «une clé de lecture qui nous appelle non seulement à ne parler que de ce que l’on connait mais également à ne parler que de ce que l’on sait faire, qu’il s’agisse de sandales, de médecine ou de maraîchage».
Oui. L’action plutôt la critique facile et inutile.
«Car au final, s’il est indispensable d’oser agir sans toujours savoir, ne serait-ce que pour expérimenter, se tromper, corriger, et finalement apprendre, on ne devrait en revanche jamais prétendre savoir sans avoir fait.»
C’est l’action qui nous apprend l’humilité, la patience, la retenue. Bref, tout ce qui est nécessaire à une parole nuancée et une pensée débarrassée des simplifications et des raccourcis.
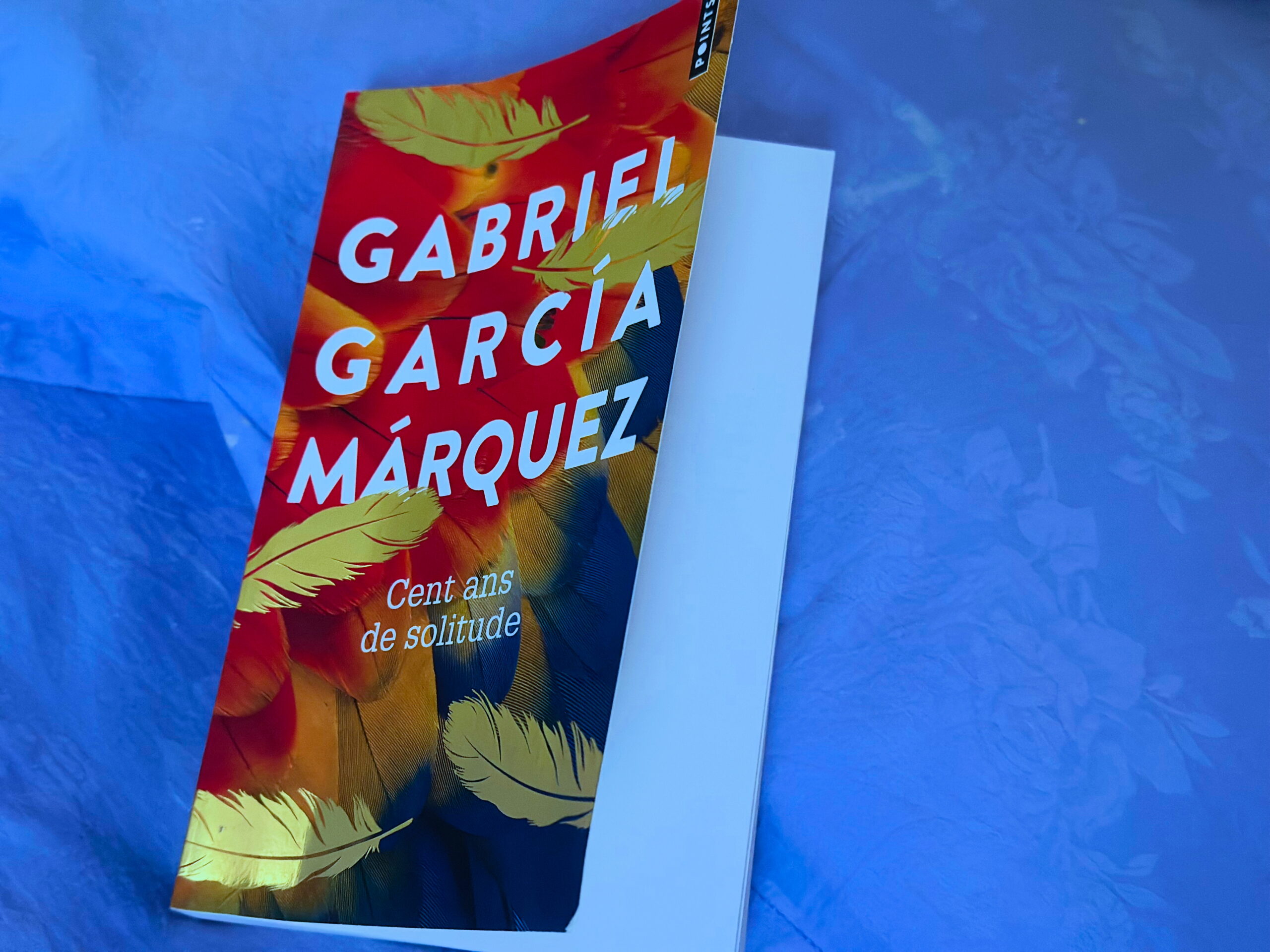
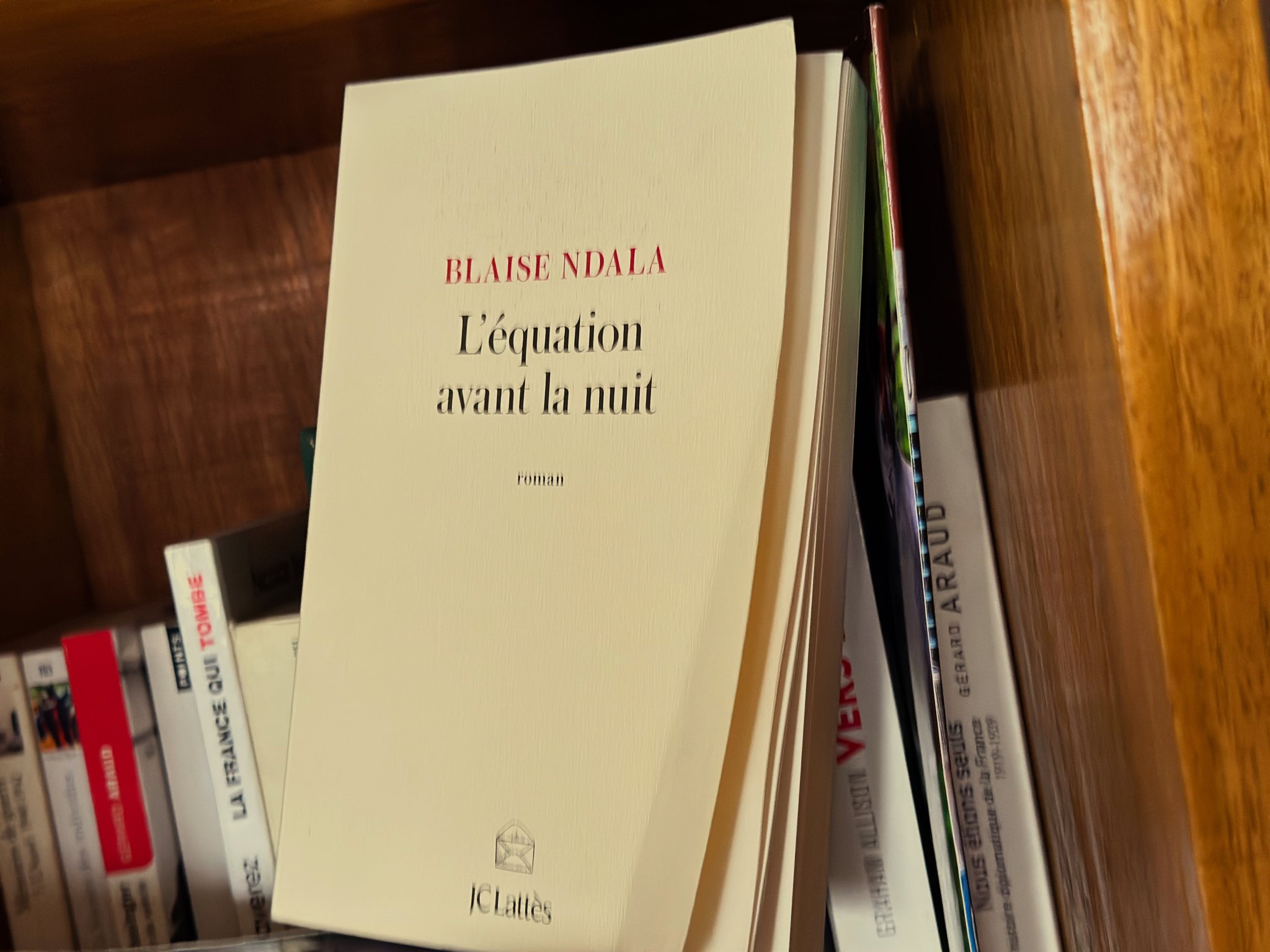











Laisser un commentaire