Deux siècles après, «De la guerre» est toujours d’actualité
Partagez maintenant sur :
Clausewitz est à l’art de la guerre ce que Machiavel est à la pensée politique. Deux maîtres dont les écrits ne perdent rien de leur actualité malgré les années qui passent. «Le Prince» publié en 1532 théorise la pratique du pouvoir. Hier comme aujourd’hui, un bon dirigeant devrait méditer ceci :
«Lorsqu’on prévoit le mal de loin, ce qui n’est donné qu’aux hommes doués d’une grande sagacité, on le guérit bientôt ; mais lorsque, par défaut de lumière, on n’a su le voir que lorsqu’il frappe tous les yeux, la cure se trouve impossible.»
Qu’est-ce que la guerre ?
Je relis «Le Prince» au moins une fois par an. Mais c’est ce matin que j’ai terminé «De la guerre». Pourtant, j’entends parler de ce livre de Clausewitz depuis l’université. C’est un ouvrage unique. Écrit par un homme qui a fait la guerre, le livre peut étonner par sa hauteur.
«De la guerre» – publié il y a deux siècles, après la mort de son auteur – est, avant tout, un livre de réflexion.
La principale idée que défend Clausewitz est que la guerre est un moyen, un instrument de la politique :
«La guerre n’est rien d’autre qu’une continuation des relations politiques par l’immixtion d’autres moyens. Nous disons ‘’par immixtion d’autres moyens’’ afin d’affirmer en même temps que ces relations politiques ne cessent pas avec la guerre elle-même. […] En tant que telle, [la guerre] ne peut suivre ses propres lois ; il faut la considérer comme une partie d’un tout plus vaste – et ce tout est la politique.»
Même aujourd’hui, il arrive que nous oubliions cette évidence. On ne fait pas la guerre pour faire la guerre. Il doit y avoir un but qui dépasse le seul cadre de la guerre et qui prend tous son sens dans la mise en perspective de la politique d’une nation.
En fait, c’est quoi la guerre ? Clausewitz en donne une bonne définition :
«La guerre est un acte de violence engagé pour contraindre l’adversaire à se soumettre à notre volonté. […] Imposer notre volonté à l’ennemi en constitue la fin. Pour atteindre cette fin avec certitude nous devons désarmer l’ennemi.»
Avant d’être un penseur, Carl von Clausewitz est un militaire. Il est admis à l’École militaire de Berlin en 1801. Il participe à de nombreuses campagnes contre l’armée de Napoléon (bataille d’Auerstaedt, campagne de Russie, campagne de Belgique, etc.). En 1818, il prend la direction de l’École de guerre générale de Berlin.
«De la guerre» transpire l’expérience de l’officier qui connaît l’odeur du champ de bataille :
«Toute activité militaire est nécessairement liée à l’engagement, de façon directe ou indirecte. Le soldat est recruté, habillé, armé, formé, il dort, boit, mange et marche, tout cela uniquement pour se battre au bon endroit et au bon moment.»
«La force l’emportera toujours sur le Droit»
La guerre, c’est le monde de l’incertitude. Elle requiert des dispositions peu communes. Clausewitz ne le sait que trop bien. Il insiste beaucoup sur les facteurs psychologiques et la force mentale nécessaire dans la conduite de la guerre.
«Si l’on embrasse du regard les quatre composantes qui constituent l’atmosphère dans laquelle évolue la guerre: le danger, l’effort physique, l’incertitude et le hasard, on conçoit alors aisément qu’il faut une grande force d’âme et d’esprit pour avancer avec sûreté et succès…», écrit-il, avant d’ajouter :
«Chez l’homme ordinaire, la liberté et l’activité de l’esprit ne sont pas accrues par le danger et les responsabilités, mais amoindries. […] lorsque ces deux facteurs renforcent le jugement et lui donnent des ailes, on est en présence d’un esprit d’une grandeur exceptionnelle.»
La guerre est un sujet difficile à appréhender pour beaucoup d’êtres humains. Trop violente, elle est souvent une source d’inquiétude plutôt de réflexion. Ceux qui l’ont connue ne veulent surtout pas la revivre. C’est légitime. Ce qui ne l’est pas, c’est refuser de s’y préparer sous prétexte d’en avoir peur.
Le 2 mars dernier sur Twitter, j’ai lu sur le compte d’Emmanuel Ruimy cette très pertinente interpellation :
«L’Europe s’est bâtie sur un traumatisme et un mensonge. Le traumatisme, c’est la guerre. Le mensonge, c\’est l\’idée que la paix s\’obtient en remplaçant la force par le droit. Terrorisée par son propre passé, l’Europe a renoncé à la puissance et confié son destin à des juristes. […] Le Vieux Continent a cru qu’il pourrait gouverner avec des chartes plutôt qu’avec des chars. Il a déclaré la guerre à la guerre, sans comprendre que la guerre continuerait sans lui. Il voulait être la conscience du monde ; il en est devenu le dindon. Effrayée par sa propre histoire, l’Europe a préféré s’effacer elle-même.»
Ces mots adressés aux Européens parlent (ou devraient parler) à beaucoup d’autres nations à travers la planète.
Comme le faisait remarquer encore récemment sur le même réseau social l’ambassadeur Gérard Araud, «la force l’emportera toujours sur le Droit».
C’est pour cette raison qu’il faut toujours être prêt militairement afin de défendre, si c’est nécessaire, le droit par les armes.
«La lâcheté est un péché irrémissible»
Le même Gérard Araud note dans «Henri Kissinger. Le diplomate du siècle» :
«La communauté internationale, c’est la cour de récréation d’où le surveillant s’est absenté. Être le plus gentil, le plus intelligent ou le plus respectueux de règlement n’y sert pas à grand-chose, c’est être le plus fort ou le plus malin qui compte. […] La solution de tout conflit est inévitablement plus proche des demandes du fort que celles du faible. Le juge suprême, ce n’est pas le droit, c’est le rapport de forces. On peut le regretter mais c’est la froide réalité du monde.»
Les hommes qui ne peuvent – ou ne veulent – pas se battre subiront nécessairement la loi de ceux qui en sont capables.
A ce propos, l’ancien président américain Theodore Roosevelt lançait cette mise en garde au début du siècle dernier :
«Toutes les grandes races dominantes ont été des races de combattants. Qu’une race vienne à perdre cette vertu guerrière et, quelles que soient ses autres qualités, aussi douée soit-elle pour le commerce et la finance, la science ou les arts, elle perd à l’instant même son droit de se dresser fièrement aux cotés des meilleures. La lâcheté, chez un homme ou dans une race, est un péché irrémissible.»
Depuis Clausewitz, le monde a beaucoup changé. On n’utilise plus les mêmes armes. Ni les mêmes techniques de combat.
Les drones, les satellites, l’intelligence artificielle. Les champs de bataille d’aujourd’hui ne ressemblent plus du tout à ce qu’ils étaient quand l’armée prussienne faisait face à celle de Napoléon.
Mais une chose n’a pas changé : l’être humain.
«L’homme suit les mêmes ambitions, nourrit les mêmes peurs et commet les mêmes erreurs de siècle en siècle», analyse Gérard Araud.
C’est pour cette raison que les Congolais doivent garder à l’esprit qu’«il ne faut pas hésiter à sortir l’épée pour éviter le pire».
Si, comme le soutient Matthieu Pigasse, «l’urgence est de répondre aux souffrances d’aujourd’hui et aux angoisses de demain», il ne faut pas fuir la guerre. Il faut la faire et la faire sérieusement.
On lit dans «De la guerre», cette exhortation :
«Un gouvernement qui, après la perte d’une bataille capitale, ne songe plus qu’à offrir rapidement à son peuple le repos de la paix et, terrassé par la chute de ses espérances, ne sent plus en lui ni le courage ni le désir de stimuler ses forces, commet une grave inconséquence.»
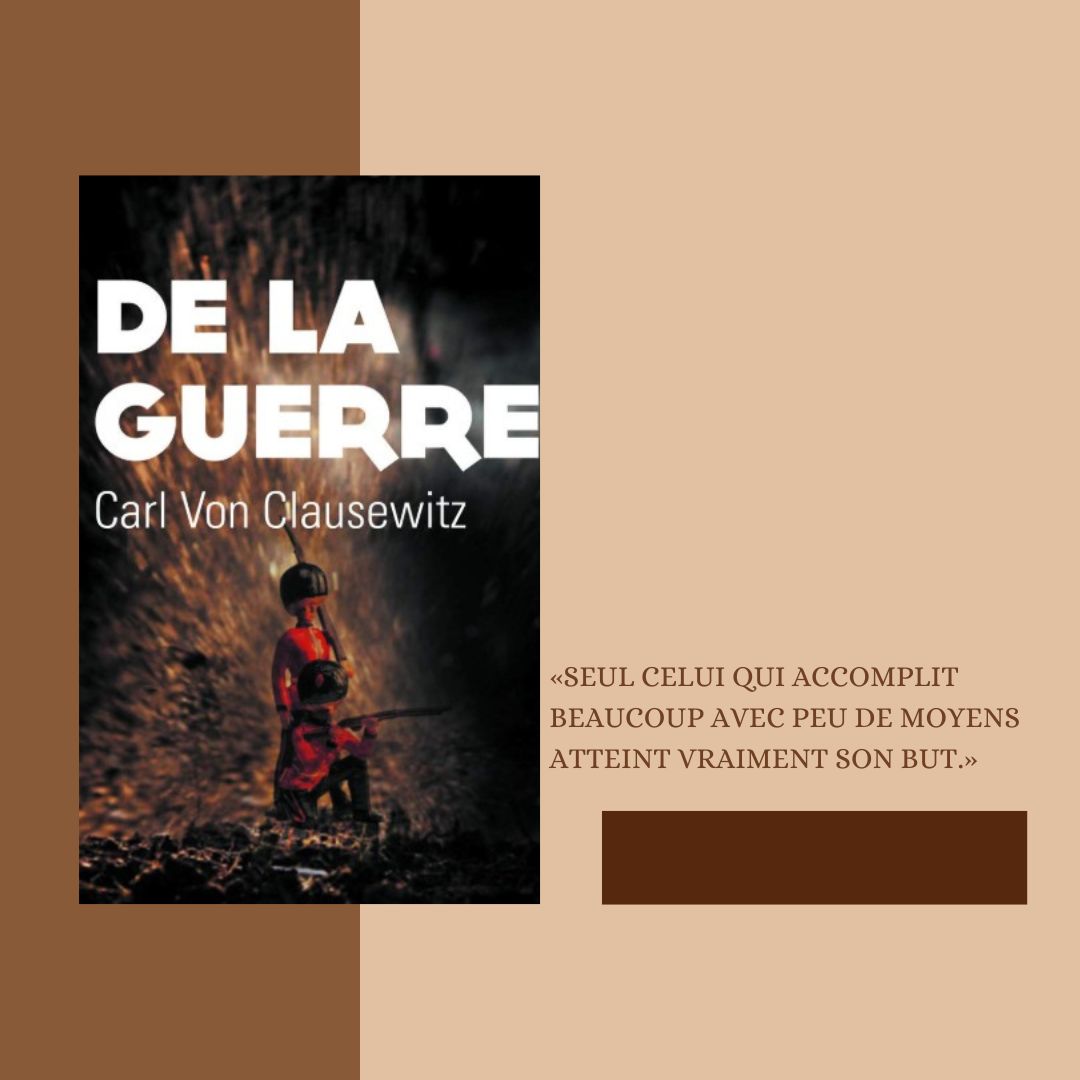













3 comments