Choisir son chemin
Partagez maintenant sur :
La Chine actuelle doit une partie de sa fulgurante ascension aux Etats-Unis. J’insiste sur «actuelle» et «une partie». J’écris «Chine actuelle» car ce pays est une civilisation plusieurs fois millénaire qui a rayonné bien avant l’Europe industrielle et les Etats-Unis triomphants. Et je ne peux attribuer qu’une partie de l’extraordinaire bond de l’économie chinoise aux Etats-Unis car, si l’ouverture décidée par le président Nixon et son conseiller Kissinger a permis de propulser ce pays dans l’économie mondialisée, les Chinois et leurs dirigeants ont fait le reste, c’est-à-dire le plus gros du travail : ils ont choisi leur chemin.
Je viens de terminer la lecture de «Vers la guerre. L’Amérique et la Chine dans le Piège de Thucydide ?». Un excellent ouvrage de Graham Allison qui évalue les possibilités d’une confrontation future entre la Chine et les Etats-Unis, en se basant sur l’histoire des puissances qui ont dominé la planète. Le Piège de Thucydide désigne l’inévitable bouleversement qui se produit quand une puissance ascendante menace de supplanter une puissance établie.
«Mais c’est impossible !»
«En 1980, très peu d’Américains se rendaient en Chine. Le pays venait tout juste de ‘’s’ouvrir’’ à l’Occident, et il était encore difficile de s’y déplacer. Ceux qui faisaient tout de même le voyage découvraient un pays qui semblait surgir de quelque passé lointain vaste, rural, immuable, impénétrable, endormi. Ils voyaient des maisons en bambou, des barres d’immeubles délabrés de type soviétique et des rues envahies de bicyclettes dont les conducteurs portaient tous un terne costume mao. […] Où qu’ils aillent, les Américains rencontraient une misère noire : sur un milliard de Chinois, 88% parvenaient tout juste à survivre avec moins de deux dollars par jour, comme cela avait été le cas pendant des millénaires avant la Révolution industrielle.»
Cette description de la Chine que l’on trouve dans le livre de Graham Allison laisse songeur quand on lit le discours prononcé en mai dernier– soit 42 ans après- par le chef de la diplomatie américaine.
Anthony Blinken a notamment déclaré que «la Chine est le seul pays qui a à la fois l’intention de remodeler l’ordre international et de plus en plus les moyens de le faire sur les plans économique, diplomatique, militaire et technologique».
Qu’est-ce qui a donc bien pu se passer en quarante ans pour que la Chine passe d’un pays moyenâgeux en une puissance capable de rivaliser avec les Etats-Unis ?
L’ascension chinoise est si fulgurante qu’elle étonne même l’un des artisans de l’ouverture américaine vers la Chine. Graham Allison cite ainsi une déclaration d’Henry Kissinger :
«Si l’on m’avait montré en 1971 une photo de Pékin d’aujourd’hui en me disant que, dans un quart de siècle, la ville aurait cet aspect-là, j’aurais jugé la chose absolument impossible.»
L’ancien secrétaire d’État américain n’est pas le seul à ne pas avoir été capable d’imaginer l’ascension fulgurante de la Chine.
Comme le note G. Allisson, «pour les Américains, […] l’idée que la Chine puisse devenir la première économie du monde à la place des États-Unis est impensable».
Pourtant les chiffres sont là : en 2016, la Chine représentait environ 18% du PIB mondial- contre 2% à peine en 1980.
En 2014, après la publication du rapport annuel du FMI sur l’économie mondiale, «MarketWatch» titrait : «Ne mâchons pas nos mots : nous ne sommes plus numéro 1».
De son côté, le «Financial Times» notait : «C’est désormais officiel. Pour l’année 2014, le FMI a évalué l’économie américaine à 17,4 trillions de dollars et la chinoise à 17,6 trillions».
Je vais tout de suite dire que, rigoureusement, la Chine n’est pas encore la première économie du monde. Les États-Unis sont encore en première position.
Mais ce que les chiffres montrent de manière évidente est que les Chinois se sont tellement rapprochés des États-Unis que ceux-ci sont actuellement obligés de définir une politique spécifique pour contenir l’ascension de la Chine.
Ce qui est pour le moins étonnant.
Nixon, Kissinger, «la ruse la mieux ourdie…»
Dans «Vers la guerre», Graham Allison relate qu’en 1969, le président Richard Nixon nomme Henry Kissinger, professeur à Harvard, conseiller à la sécurité nationale et lui confie qu’il veut rétablir les relations avec la Chine :
«Lorsque Nixon et Kissinger ont étudié la possibilité d’une ouverture vers la Chine, nul n’imaginait que cette dernière deviendrait de leur vivant une économie aussi vaste et aussi puissante que celle des États-Unis. Les deux hommes étaient concentrés sur l’adversaire soviétique de l’Amérique, et leur projet était avant tout de diviser le bloc communiste en creusant le fossé sino-soviétique.»
«Ils sont eu raison, commente Graham Allison, mais vers la fin de sa vie, revenant sur les évènements tels qu’ils se sont succédé, Nixon a confié à son ami William Safire, autrefois chargé d’écrire ses discours : ‘’Nous avons peut-être créé un monstre de Frankenstein’’.»
Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à «La grenouille et le rat» quand j’ai lu cet extrait. Cette fable de Jean de La Fontaine se termine ainsi :
«La ruse la mieux ourdie
Peut nuire à son inventeur ;
Et souvent la perfidie
Retourne sur son auteur.»
Ce que m’a appris «Vers la guerre»
Le livre de Graham Allison a été une lecture passionnante. J’y ai beaucoup appris. Sur les relations internationales. La géopolitique. La politique des puissances. La construction d’une puissance. La genèse des conflits entre puissances. L’importance de la stratégie.
J’ai découvert l’ouvrage en lisant un autre livre tout aussi passionnant «Dictionnaire amoureux de la géopolitique» d’Hubert Védrine.
Les deux publications ont ceci en commun : elles rappellent aux dirigeants des pays qu’au centre de l’action politique, il y a d’abord la pensée stratégique.
Définir le destin que l’on veut construire. Savoir quel chemin on va emprunter. La direction que l’on va suivre. Les moyens qui seront nécessaires. Les sacrifices que l’on va devoir s’imposer. Tout ceci doit paraître comme une évidence pour les personnes qui président à la destinée d’une nation.
«Si l’élaboration méticuleuse d’une stratégie ne garantit nullement son succès, l’absence de stratégie cohérente et envisageable sur la durée a toutes les chances d’aboutir à un échec», écrit Graham Allison.
L’ascension de la Chine n’est pas le fruit du hasard. S’il est honnête de reconnaître le coup de pouce initial des États-Unis dans le but de contrecarrer l’Union soviétique, la lucidité commande d’apprécier la ténacité, le courage, la volonté et l’intelligence dont les Chinois et leurs dirigeants ont fait preuve pour en arriver là où ils sont actuellement.
«Le destin distribue les cartes, mais ce sont les hommes qui jouent la partie.»
Les Chinois ont fait des choix. Certains sont contestables. D’autres détestables. Mais c’est leurs choix.
Dans son livre, Graham Allison reprend la réponse d’un capital-risqueur de Shangaï à qui l’on a demandé un jour quelle était la légitimité du Parti communiste chinois qui n’a jamais été élu. Sa réponse :
«Les faits sont connus. En 1949, quand le parti est arrivé au pouvoir, la Chine était plongée dans la guerre civile, démembrée par des agressions étrangères, et à cette époque l’espérance de vie atteignait à peine les 41 ans. Aujourd’hui, la Chine est la deuxième économie mondiale, c’est un géant industriel et sa population jouit d’une prospérité croissante.»
Explication : la performance justifie le régime du parti unique.
L’on peut ne pas être d’accord avec cette façon de penser. Mais c’est une façon de penser comme une autre. Qui a le mérite d’exister.
C’est en cela que l’exemple chinois est instructif pour les Africains. Que l’on me comprenne bien. Je ne suis pas en train de défendre les choix politiques de la Chine.
Je défends l’idée que chaque peuple doit choisir son propre chemin. Déterminer quelle voie il veut emprunter pour aller vers le progrès et construire son propre destin.
Les systèmes politiques et les courants économiques sont des outils. Ils doivent servir à quelque chose. Et si un outil ne donne pas le résultat que l’on en attend, on doit pouvoir le changer. La démocratie, le libre-échange, le libéralisme sont des options. En aucun cas, ils ne doivent être considérés comme une fin en soi. C’est aux Africains de décider du chemin qu’ils veulent emprunter et de la destination.
J’ai terminé la lecture de «Vers la guerre» le matin de Noël. En retard sur mon programme de lecture, j’ai aussitôt entamé «L’urgence africaine» de l’économiste togolais Kako Nubukpo. Le livre commence bien. Dès la première page, on peut lire à propos de l’Afrique :
«Nous avons affaire à un continent cobaye, un véritable laboratoire des postulats, axiomes, idéologies, théories et empiries divers et variés en provenance du reste du monde qui s’y rue, tels des vautours sur leur proie.»
Je reviendrai vous en parler !


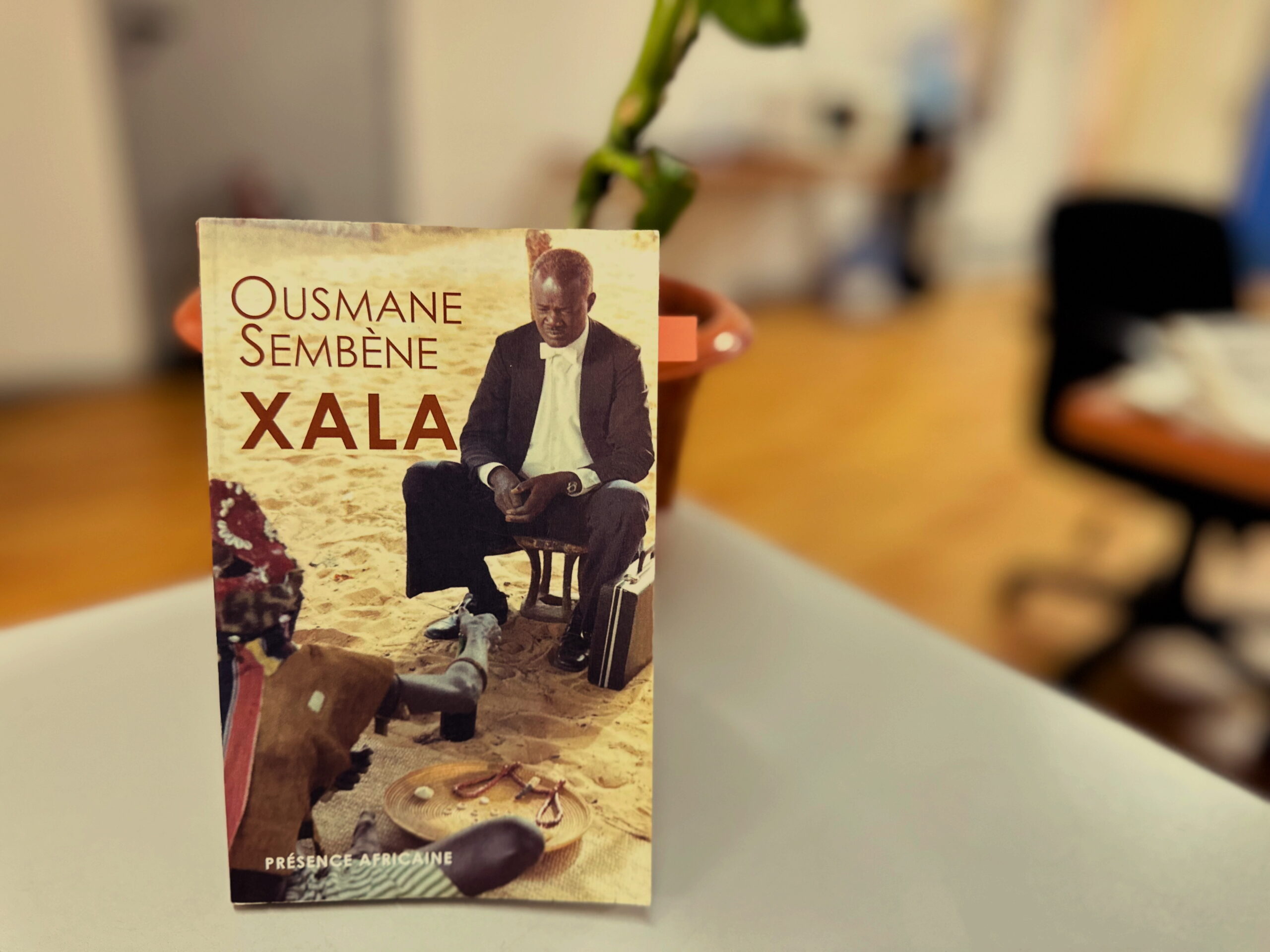










2 comments